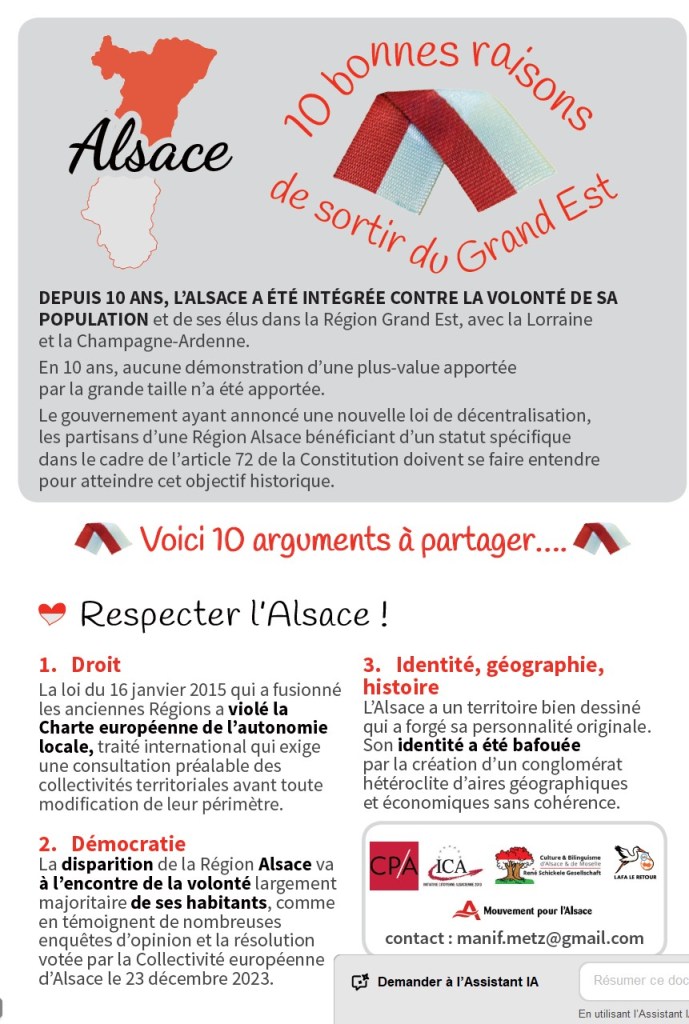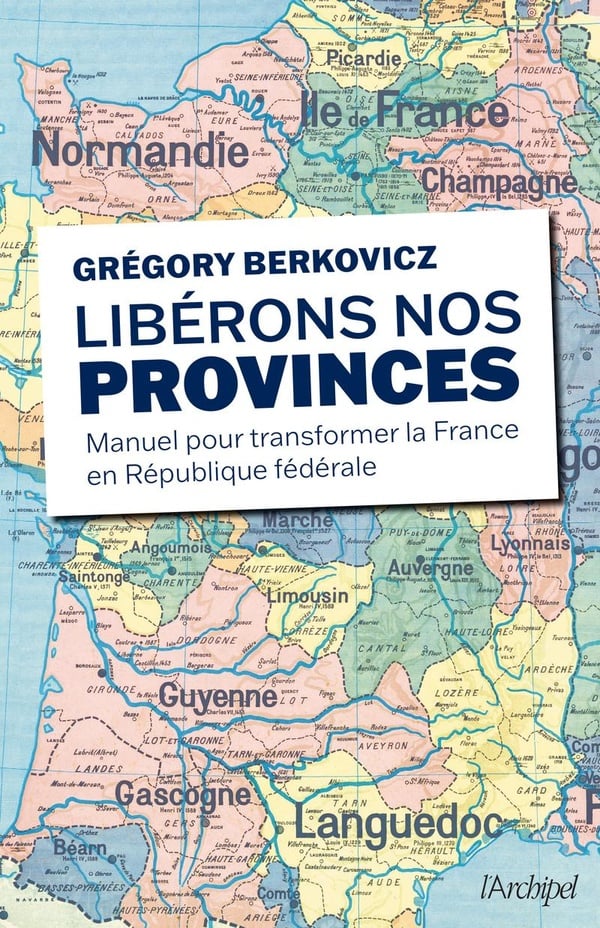Découvrez les résultats de notre nouveau sondage Ifop : présentation du sondage simplifiée, ou le rapport complet (pdf)
Dévoilé à la Maison de l’Alsace à Paris, le sondage a été présenté par Jérôme Fourquet, directeur à l’Ifop. Qualifiant le résultat de « massif », il a souligné qu’on se situe même à un niveau un peu plus élevé que les sondages précédents.
De plus, Jérôme Fourquet a également insisté sur le fait que les résultats « transcendent les catégories ». Quels que soient l’âge, la taille des villes, le sexe, les catégories sociaux-professionnelles, le Oui est systématiquement au-dessus de 60%. Ces résultats sont plus homogènes également que lors des précédents sondage.
Les Alsaciens veulent mettre fin à cette « absurdité »
Alors que le gouvernement cherche des économies tous azimuts, la refonte de l’organisation territoriale qu’Emmanuel Macron avait qualifiée de confuse et de coûteuse[1], est plus indispensable que jamais.
François Bayrou a qualifié d’absurdité la fusion des régions, ciblant notamment le Grand Est. A juste titre, tant la fusion s’est soldée par un fiasco, générant des surcoûts au lieu des économies promises.
Créer une collectivité régionale Alsace revient à supprimer une strate en créant une Collectivité d’Alsace unifiant les compétences régionales et départementales. Ce statut unique en lieu et place de la CeA et de la Région Grand Est peut s’opérer par une simple loi ordinaire (article 72 de la constitution).
Or, le sondage IFOP est sans appel. 72% des Alsaciens souhaitent cette unification, le plus tôt possible, et déclarent que passer par un référendum – si nécessaire – n’est pas un obstacle à cet égard. Ce soutien massif réunit à parts sensiblement égales tous les segments de la population : femmes et hommes, jeunes et vieux, ruraux et urbains, ouvriers et cadres.
100 millions d’euros d’économies en dépenses de fonctionnement
En éliminant de nombreux doublons, la suppression d’un échelon constituerait un « choc de simplification ». A la clé, selon nos estimations dont nous publierons bientôt plus détails, les économies réalisées seraient de l’ordre de 100 millions d’euros par an. Portant uniquement sur les charges administratives générales, elles n’altéreraient en rien les services rendus à la population.
Outre les économies budgétaires, la nouvelle Collectivité pourrait répondre aux enjeux spécifiques de l’Alsace, notamment dans les relations transfrontalières cruciales pour son développement économique et environnemental.
Un enjeu national
L’Alsace peut être la clé de pour faire sauter les verrous paralysants toute réforme ambitieuse. Si l’expérimentation alsacienne est fructueuse, elle préfigurerait une réforme de décentralisation qui concernerait l’ensemble des authentiques régions de France.
La presse en parle :
[1] Interview Le Point du 28/08/2023.